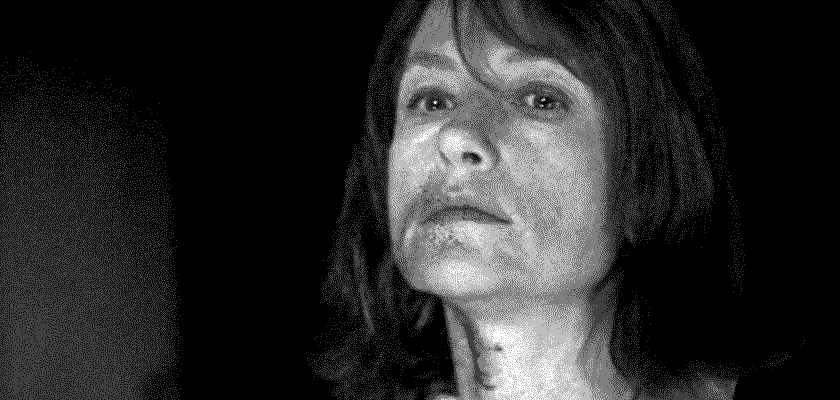
The Last of Us Part II est :
Le père à tuer
The Last of Us Deuxième Partie n’est pas mon père, d’abord.
C’est un jeu qui veut être une série télé qui veut être du cinéma qui veut être de la littérature. C’est un menu Signature du McDonald’s, dans une ville où tous les restos sont des McDonald’s. C’est un monument historique, dessiné par les meilleurs architectes, bâti par une armée d’ouvriers perfectionnistes convaincus d’édifier les masses, et à la gloire de choses que l’on connaît déjà par cœur. Dans mille ans, si l’édifice est encore debout, on s’en rappellera comme du sommet d’une civilisation révolue, en oubliant qu’avant de bâtir le Colisée, les Romains avaient l’eau courante.
En le regardant d’un côté, The Last Of Us Deuxième Partie est un récit bouleversant. En le regardant d’un autre, c’est un simulateur de meurtre fantastique. En repensant au deux en même temps, on dirait une blague. Une blague super connue d’ailleurs ; la première fois que je l’ai entendue, c’était dans le n°139 de Joypad de mars 2004, dans un article titré “Tirez sur le pianiste”, où l’auteur raconte qu’il s’est retrouvé bloqué quelques instants devant Max Payne 2 et XIII (deux simulateurs de meurtre), parce qu’il avait hésité à tirer sur, respectivement, un méchant qui jouait du piano et un méchant qui parlait de sa femme à un autre méchant. La blague, bien entendu, c’est que ni dans Max Payne 2, ni dans XIII, ni dans la majorité des jeux vidéo, on n’est censé hésiter à tirer sur un méchant au prétexte qu’il est peut-être gentil.
Dans The Last of Us 2 non plus, et pourtant. S’il y a une chose claire dans ce jeu trop long et trop confus, c’est qu’il ne manque pas une occasion de nous rappeler, tout au long de ses 30 ou 40 heures, que Ceci N’est Pas Une Blague.
Chapitre 1 : The Last of Us Première Partie
Si tout le monde a adoré The Last of Us Première Partie (“récompensé Jeu de l’Année plus de 200 fois”, c’est écrit sur la jaquette), c’est certes parce qu’il est très beau et très émouvant, mais aussi parce qu’il est très cohérent : l’action, ce qu’on fait dans le jeu (ce qu’on appelle traditionnellement “gameplay”) correspond parfaitement à la narration, ce que le jeu essaie de nous raconter. En l’occurrence, la narration c’est “apocalypse zombie”, et l’action c’est donc “tuer des gens”, car comme nous l’apprennent la quasi-totalité des histoires d’apocalypse zombie, les gens sont les vrais monstres. Évidemment, TLoU1 n’est pas le premier jeu à avoir eu cette idée, mais c’est un des premiers à vouloir prendre la chose au sérieux, à proposer au joueur de tuer plein de gens et de vivre une grande histoire sans que cela ne tourne en une blague.
Le début de TLoU n’est certainement pas une blague. Des innocents meurent. La société s’effondre, et avec elle, toute notion de bien et de mal. Désormais, c’est tuer ou être tué. Du début jusqu’à la toute fin de The Last of Us Première Partie, à aucun moment on ne tire sur un pianiste : les “gentils” entrent et sortent de la scène via des cinématiques. Par convention vidéoludique, les autres sont tous méchants, et d’ailleurs si vous vous amusez à essayer de démontrer le contraire, vous aurez un Game Over. Et puis, à la toute fin du jeu, dans une cinématique, le héros que vous incarnez franchit la ligne jaune et agresse des gens qui, a priori, ne vous voulaient pas de mal. Quand l’action reprend, vous vous retrouvez à vous défendre contre ces gens qui certes, essaient désormais de vous tuer, sauf que c’est vous qui avez commencé. Et après avoir atteint votre objectif (peut-être même en vous faufilant discrètement pour ne tuer personne, comme je l’avais fait à l’époque), là, le jeu vous demande de tirer sur un pianiste.
Les jeux vidéo, en tout cas ceux qui coûtent suffisamment de sous pour que les joueurs remarquent leur existence, sont notoirement mauvais dès qu’il s’agit de nous faire tirer sur un pianiste, mais ça ne les empêche pas d’essayer. Spec Ops: The Line, un simulateur de meurtre jaune-pisse qui refait Apocalypse Now Chez Les Arabes, nous contraint à un moment donné de tirer au phosphore blanc sur des dizaines de pianistes, avant de nous réprimander dans ses écrans de chargement, comme si on avait fait exprès de tuer ces civils innocents ; un critique a écrit un bouquin de 150 pages sur ce jeu. Et ça, c’était un an avant The Last of Us Première Partie, où là aussi, il n’y a pas d’autre échappatoire que tuer le pianiste. La différence, c’est que dans Spec Ops: The Line, ce moment sert à nous apprendre qu’à la guerre, surtout la guerre à l’américaine du XXIe siècle, on finit toujours par tirer sur des pianistes, et que si vous pensiez oublier ça en jouant à un jeu de guerre, vous êtes bien naïfs, et d’ailleurs le jeu n’est pas terminé, allez-vous continuer à tirer sur des pianistes juste pour en voir la fin, quels monstres vous faites – bref, ce jeu est une blague. (Qui a toutefois le mérite d’être délibérée.)
Dans TLoU1, ce moment sert à nous faire réaliser que TLoU1 est vachement meilleur que Spec Ops: The Line. Il aurait pu s’agir d’une simple cinématique où Joel, notre héros meurtrier, fait ce qu’il a toujours fait pendant tout le jeu : protéger Ellie, l’adolescente innocente qui nous accompagne dans ce voyage parmi les zombies et les sauvages. À ce stade du jeu, il l’aime comme sa fille. Un pianiste n’est qu’un mort de plus à ses yeux. Pourquoi ne serait-ce pas pareil aux nôtres ? Nous aussi, avons passé 10 heures avec Ellie à la protéger (enfin à faire semblant, vu qu’elle est immortelle), à écouter ses blagues, à voir son innocence souillée par les meurtres et la folie humaine qu’il nous a fallu perpétrer pour notre survie. Contrairement à Spec Ops qui nous fait livrer une guerre débile avant de nous le reprocher, TLoU nous fait sentir comme un gentil sur une planète de méchants. Quand quelque chose de différent se met en travers de notre chemin, il est trop tard pour changer de vision du monde. J’ai tiré à contre-cœur sur le pied du pianiste (ça le tue aussitôt), et après quelques instants, en repensant à tout ce qu’on a vécu ensemble, j’ai compris que c’est ce que Joel aurait fait, et je l’ai accepté.
Maintenant, si je vous disais que dans The Last of Us Deuxième Partie, tout le monde est un pianiste ?
Chapitre 2 : The Last of Us Deuxième Partie
Si je parle autant de TLoU1 avant de parler de TLoU2, c’est parce que TLoU2, c’est un peu le même jeu.
C’est-à-dire que c’est un simulateur de meurtre post-apocalyptique. On rampe derrière les ennemis pour les choper par-derrière, les tirer dans un coin discret pendant qu’ils marmonnent quelque chose (ça va de “on se calme” à “ça ne sert à rien” en passant par “pitié” ou “de toute façon t’es moche”), avant de leur faire un trou dans la carotide. Ou alors on peut utiliser des silencieux ou des flèches pour descendre des gens sans faire de bruit. Au bout d’un moment, on finit par se faire griller, les zombies se mettent à gueuler, les méchants crient “oh mon dieu, ils ont tué Machin !” et c’est parti pour le carnage. C’est le même vocabulaire, enrichi de quelques mots (tels les chiens, qui flairent votre piste et vous forcent à ne pas camper) qu’emploient TLoU2 et TLoU1, ce dernier l’ayant lui-même hérité de ce qu’on appelle les jeux d’infiltration ; leurs plus célèbres représentants étant les Metal Gear Solid, des jeux très, très intéressés par le dilemme du pianiste (et qui n’ont pas peur d’être des farces monumentales). Quand vous ne tuez pas des gens, vous êtes invités à fouiller chaque recoin à la recherche des rares denrées abandonnées parmi les vestiges de la civilisation. De temps en temps, il faudra résoudre des petites énigmes. Parfois, vous vous contentez de vous balader en regardant les personnages discuter, sans pouvoir tirer sur personne. Et bien entendu, vous avez des cinématiques.
Telle est la formule de The Last of Us, une formule qui convient parfaitement à l’aventure de Joel, où il fait – avec nous – tout ce qu’on vient de décrire, jusqu’à ce point culminant où il tire sur le pianiste et fait s’effondrer nos convictions morales de meurtrier post-apocalyptique. C’était d’une logique imparable. Après un tel rebondissement, l’absurdité de notre aventure était révélée, et l’histoire pouvait s’arrêter là. D’ailleurs, elle s’arrêtait là.
Jusqu’à maintenant !
Je ne sais pas à quel moment précis j’ai rompu mon pacte avec le jeu, quand est-ce que j’ai cessé d’être personnellement impliqué dans son histoire comme j’ai pu l’être avec TLoU1. Peut-être était-ce bien avant qu’il me fasse à nouveau tirer sur des pianistes, peut-être que dès le départ j’avais pris trop de recul sur cette énième histoire de zombies, en pensant que tout avait déjà été dit dans le jeu d’avant sur ces pauvres hères écartelés entre tribus belliqueuses, dévorés par la rancune dans un monde sans justice, “les derniers d’entre nous” comme dit le titre. Peut-être aussi que je n’avais pas besoin de passer dix heures avec la fille du pianiste pour comprendre son geste, parce que j’avais déjà fait TLoU1 et que dans les bottes de Joel, j’avais déjà compris pourquoi on tuait des innocents. Peut-être que je n’avais pas besoin d’une “deuxième partie” à un jeu dont la fin était définitive pour comprendre que la violence entraîne la violence, que les gens sont les vrais monstres, que nous sommes tous des pianistes (sauf les cannibales, les pédophiles et les esclavagistes), bref que tout ce qu’on peut faire dans ce monde, c’est le mal.
Au final, les moments où j’ai pris le plus de plaisir dans TLoU2, c’est ceux où j’assassinais tous les mecs que je croisais. Qu’est-ce que t’as à répondre à ça, hein papa ?
Tout le paradoxe est là : le jeu a beau faire pleurer ses chiens quand on tue leur maître, il n’en reste pas moins un jeu de tir, où le meurtre est le cœur de l’action, la raison pour laquelle il se vendra par palettes entières. TLoU1 avait la même démarche, mais en proposait une approche supérieurement intelligente : sa société post-apo, ses passages contemplatifs, son fameux pianiste, même ses clichés de cinéma hollywoodien post-11-septembre, tout cela venait à l’appui de la violence qu’il exigeait du joueur. En comparaison, TLoU2 semble à côté de la plaque. On s’éclate à faire des trous dans des carotides jusqu’à ce qu’une cinématique montre notre personnage traumatisé. On prend plaisir à triompher des salauds qui nous canardent jusqu’à ce qu’il faille appuyer sur Carré pour torturer. Sauf que je n’avais plus que faire des pianistes : j’appuyais sur Carré pour aller à la scène suivante, sans me sentir davantage impliqué, comme dans n’importe quel jeu de tir. C’était comme alterner un niveau de Doom et une séquence de série télé prestigieuse, ce que j’imagine être The Walking Dead si j’avais regardé The Walking Dead.
Dire une chose pareille de n’importe quel jeu de tir pourrait passer pour un compliment ; après tout, de la bonne action comme dans Doom avec de la bonne narration comme sur HBO (c’est bien sur HBO les séries télé prestigieuses ?), c’est plutôt pas mal. Mais dire ça de The Last of Us Part II, La Suite de The Last of Us Récompensé Jeu de l’Année Plus de 200 Fois, c’est presque faire un constat d’échec du médium vidéoludique tout entier. Ce n’est même plus tirer sur l’ambulance, c’est affirmer qu’elle répand le Covid. TLoU2 était l’élu ; TLoU2 devait rétablir la paix dans la force, pas la condamner à la nuit. Et le pire, c’est que j’ai passé de très bons moments devant ce jeu !
Mais j’ai tout de même l’impression que c’est devenu une blague.
Chapitre 3 : Les gens qui ont fait TLoU2
Il se trouve que la blague dont on parle ici a un nom, et c’est la “dissonance ludonarrative”.
C’est ce qu’il se passe lorsque l’action raconte le contraire de la narration ; lorsque, contrairement à TLoU1, l’action et la narration cessent d’être intimement liés et vont parfois s’opposer frontalement. Le terme a été popularisé en 2007 par Clint Hocking (réalisateur de Far Cry 2 et Watch Dogs Legion), en expliquant comment BioShock, sorti cette année-là, vous donne d’un côté la liberté de tirer sur les pianistes (qui sont ici des petites filles sans défense) pour augmenter ses stats et être plus fort dans le jeu, et d’un autre côté vous impose de faire des choses altruistes et de bien vouloir aider les gens pour coller à l’histoire du jeu, alors que ladite histoire se déroule dans une utopie politique bâtie autour de la pensée d’Ayn Rand, une philosophe du XXe siècle pour qui (selon les devs de BioShock) l’altruisme c’est pour les cucks et il faut tirer sur les pianistes si ça peut faire augmenter ses stats. Dit comme ça c’est un peu décousu, alors voici un autre exemple : dans la série des Uncharted, dont le premier épisode est sorti la même année que BioShock, le personnage principal est un chasseur de trésors sympathique et amusant, mais le jeu est un jeu de tir, du coup vous vous retrouvez à kalasher la moitié de la population du Sri Lanka sans que cela ne cause d’états d’âme à notre héros. Dans Uncharted 2, le méchant, qui n’est certainement pas un pianiste, lance au gentil « vous n’êtes pas différent de moi, combien d’hommes avez-vous tué rien qu’aujourd’hui ? ». Le gentil semble brièvement affecté par cette réflexion, puis profite d’un deus ex machina pour rester gentil.
Ça, c’était en 2009. Parmi les scénaristes d’Uncharted 2, se trouve Neil Druckmann, qui co-réalisera The Last of Us quatre ans plus tard, puis The Last of Us Part II sept ans après. C’est dire si on a dû la lui faire souvent, cette blague.
La chose cruciale à retenir ici, c’est que la dissonance ludonarrative ne se manifeste réellement que lorsque la narration prend tant d’importance dans un jeu qu’elle doit se reposer sur l’action pour être crédible, et vice-versa. Quand la narration n’est pas un aspect essentiel du jeu, comme dans Super Mario Bros., on peut faire fi de cette interdépendance. Et historiquement, la majorité des jeux vidéo étaient comme Super Mario Bros. : des jeux d’action, sans ambition narrative, le plus souvent pour les enfants. Au moment de faire Doom, un des premiers jeux populaires qui n’était clairement pas pour les enfants (de fait, un des premiers jeux de tir assez saisissant pour être qualifié de “simulateur de meurtre”), ses développeurs ont d’abord écrit une histoire alambiquée avant de l’abandonner et de faire de Doom un jeu pratiquement sans narration, le co-créateur John Carmack ayant eu cette réflexion célèbre : « L’histoire dans un jeu vidéo, c’est comme dans un porno, on s’attend à ce qu’il y en ait une mais ce n’est pas si important ». Depuis cette époque, les simulateurs de meutre sont devenus les jeux les plus populaires au monde (avec les simulateurs de foot), John Carmack a arrêté de faire des jeux vidéo, et une génération de game designers comme Neil Druckmann se sont attelés à démontrer que Carmack avait tort.
Carmack a toujours eu tort, en réalité, mais en jouant à BioShock ou Uncharted, on pourrait penser qu’il a raison. Quelle histoire raconter dans un jeu de tir sans que cela ne devienne une blague ? Neil Druckmann, avec ses collègues de Naughty Dog, en ont fait leur mission. Forts de leur expertise technique exceptionnelle et des millions qu’ont rapporté leurs précédents jeux (pour enfants), ils ont mis au point un modèle, un format de jeu vidéo qui associe intimement simulation de meurtre et narration cinématographique, un format taillé pour vaincre la dissonance ludonarrative, et qui est devenu, à travers le succès fracassant des Uncharted et de TLoU, un exemple à suivre pour toute une industrie en manque de prestige, dans un monde où les plateformes multijoueurs en ligne et les gacha games gratuits sur téléphone, plus rentables et moins artistiques, menaceraient de donner raison à John Carmack, de rabaisser le jeu vidéo au rang de porno.
(vous imaginez, dans les années 90, un adulte voir un gamin jouer à Mario et lui dire, ou plutôt dire à ses parents : “ça ne vaut pas mieux qu’un PORNO” ? Bizarrement, moi oui. Je l’imagine même passer à la télé, ce monsieur-là. Peut-être même qu’il y passe encore aujourd’hui. Peut-être que Neil Druckmann, quand il va rentrer ses agneaux dans l’enclos de sa ferme idyllique, imagine lui aussi cet homme-là, tapi dans l’ombre, prêt à le rabaisser au rang de pornographe. Mais je m’égare.)
En d’autres termes : vous savez qu’un jeu vidéo est prestigieux quand il ressemble à un jeu Naughty Dog. Lorsque, dans un jeu d’action, vous vous retrouvez à vous balader en regardant vos personnages discuter, sans pouvoir tirer sur personne, vous savez que ses développeurs, ou bien leurs employeurs, ont vu TLoU1 et se sont dits : c’est comme ça qu’il faut faire. The Last of Us est le père du jeu AAA artistique, de l’expérience interactive pour adultes qui se prend au sérieux, du simulateur de meurtre qui ne tourne pas à la blague.
Alors que toute la blague dans The Last of Us Part II, c’est que si le personnage que l’on joue réfléchissait deux minutes à ce qu’il est en train de faire, le jeu s’arrêterait brusquement, et on n’aurait plus qu’à poser la manette et regarder les cinématiques.
John Carmack a toujours eu tort, car le jeu vidéo a fait preuve d’ambition narrative bien avant que Doom renonce à la sienne. Il y a des tas de façons de raconter des histoires en jouant, en particulier des histoires qui n’impliquent pas de commettre des meurtres pendant trente heures. Mais comme TLoU2 est, grosso modo, le même jeu que TLoU1, TLoU2 est donc condamné à raconter la même histoire. Lorsqu’il essaie d’en raconter une autre, il échoue là où TLoU1, lui, triomphait, en nous faisant arrêter de tuer des gens pile au moment où ça devenait embarrassant. L’erreur dans laquelle Naughty Dog, et tout un pan de l’industrie, se sont fourvoyés et continuent de se fourvoyer, c’est de croire que leur format bien particulier de jeu de tir était la forme suprême de narration vidéoludique. Quand on lit Neil Druckmann raconter au Washington Post ou à GQ (des journaux prestigieux n’est-ce pas) que TLoU2 est censé nous faire ressentir une « haine universelle », pour mieux nous faire « regretter » nos actes et nous « sentir sales », on peut légitimement se dire que nous faire tirer pendant trente heures sur des branquignoles qui veulent tous nous faire la peau n’est peut-être pas la manière la plus efficace de faire passer ce message. Mais il faut croire, en lisant les critiques dithyrambiques (et elles sont nombreuses, particulièrement en France), que c’est la plus prestigieuse.
Vous savez qui d’autre voulait faire des jeux prestigieux qu’on prend au sérieux ? David Cage. Vous voyez bien qui c’est David Cage ? Le premier développeur à avoir eu la Légion d’honneur ? Vous savez ce que c’est au moins, la Légion d’honneur ?
Chapitre 4 : Les gens qui ont fait que les gens ont fait TLoU2
Les journalistes de séries télé s’en lamentent, ou s’en moquent, régulièrement : le prestige, chez eux, c’est quand on dit d’une série qu’elle est “comme un film”. The Last of Us Part II est au jeu vidéo ce que la prestige TV est aux séries TV, c’est-à-dire, avant tout, un bon moyen de se faire mousser, indépendamment de toute qualité réelle. TLoU2 est censé être un jeu vidéo, mais ses meilleurs aspects sont le jeu d’acteur et l’esthétique des plans, comme dans un film, non pornographique. Le critique Stephen Beirne a eu une formule assassine à propos du premier TLoU : « tout ce que les critiques ont aimé dans ce jeu peut être résumé en un film de 3 heures » – et sur les mots “film de 3 heures”, il avait mis un lien vers une de ces vidéos “The Movie”. où, effectivement, les cinématiques du jeu étaient montées bout à bout par des fans pour faire un film de 3 heures. Lorsque Victor Moisan et Jérome Dittmar croisent la plume pour louer le « chef d’œuvre de mise en scène vidéoludique » qu’est TLoU2, ils citent 12 réalisateurs de cinéma, ainsi que 2 séries télé dont une réalisée par un cinéaste. Ils citent aussi quelques jeux vidéo, toujours les mêmes – Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3, Resident Evil 4, Gone Home, Papers, Please – tous sortis avant même le premier TLoU, tous meilleurs que TLoU2 dans ce qu’ils essaient chacun de faire, tous “prestigieux” pour ceux qui s’intéressent aux jeux vidéo pour d’autres raisons que le jeu d’acteur ou l’esthétique des plans.
Mais pour les autres, apparemment, le prestige vidéoludique, c’est d’être adapté en série HBO. Au moins, comme ça, ça règle le problème de la dissonance ludonarrative.
Soyons bien clairs : le souci ici n’est pas que les jeux vidéo empruntent les techniques narratives du cinéma ou de la série télé. Le problème est qu’ils empruntent une certaine idée de “prestige”, celle qui correspond au pognon, et à l’imitation du pognon. Il faut des montagnes de pognon pour qu’un jeu comme The Last of Us Part II ressemble à un film, pour que ses personnages ressemblent à des humains, pour que son décor ressemble à la vraie vie. Quand on connaît un minimum les conditions de travail épouvantables qui permettent d’atteindre ce niveau de mimétisme, on ne peut plus s’empêcher de serrer des dents en voyant un câble s’enrouler avec un réalisme bluffant, un sac de céréales se vider après qu’on lui a tiré dessus, ou des testicules de cheval se contracter sous l’effet de la météo ; le tout, bien sûr, au service d’une expérience vidéoludique qui ne peut se passer de ce genre de détails, car après avoir goûté au prestige, les autres jeux en deviennent obsolètes. D’ailleurs, j’espère que vous n’avez pas acheté une PS4 exprès pour TLoU2, parce que si ça se trouve dans un an, y’aura plus rien qui sortira dessus, ou alors en 720p et 30 FPS.
Tout ce pognon, les studios de jeu vidéo le dépensent pour pouvoir le regagner. Dès lors, il ne suffit plus de ressembler à une série télé de prestige pour avoir les 70 € du joueur, car ledit joueur sera prompt à remarquer que s’il voulait avoir l’impression de regarder une série, il regarderait une série ; il faut que le jeu reste un jeu, or il se trouve que les jeux les plus populaires sont ceux où l’on tue plein de gens. C’est là le véritable sens du “triple-A”, cette dénomination empruntée aux agences de notation financières qu’on plaque sur les jeux les plus prestigieux, ceux qui ont coûté du pognon et sont sûrs d’en rapporter. En 2016, Rami Ismaïl de Vlambeer me disait que Naughty Dog avaient peut-être été les premiers à désigner leurs jeux comme des “quadruple-A” ; aujourd’hui, en 2020, Ubisoft et Microsoft écrivent “AAAA” dans leurs offres d’emploi pour recruter les nouveaux animateurs de testicules de cheval qui bâtiront le futur du jeu vidéo.
The Last of Us Deuxième Partie n’est pas le futur du jeu vidéo. C’est le minimum syndical, comme le disait Leigh Alexander à propos du premier The Last of Us à l’époque. Le premier TLoU, tout aussi efficace qu’il fût, était une histoire de daron brisé qui bute des zombies pour protéger un enfant. Le deuxième TLoU, même s’il n’est jamais plus intéressant que ça, a le mérite d’élargir son univers et d’aborder des thématiques plus variées, et c’est la moindre des choses quand on prétend raconter une histoire pendant trente heures et qu’on a coûté des centaines de millions de dollars (même l’ancien patron des studios Sony trouve que c’est trop). Qu’on soit si nombreux à y voir la forme parfaite de la narration vidéoludique ne dit rien de bon sur l’état actuel du jeu vidéo. N’y a-t-il donc que dans les triple-A que le jeu vidéo peut être de l’art ? Dit-on des films les plus chers et les plus violents qu’ils sont les meilleurs ? Il serait grand temps de tuer le père, ou plutôt, puisqu’il nous a appris que tuer c’est mal (et qu’après l’apocalypse, l’herbe repousse, les gens sont toujours homophobes et les noirs meurent toujours en premier), il serait temps de lui montrer qu’on est plus intelligents qu’il ne le pense, qu’on a pas besoin de lui et de tout son fric pour vivre des histoires à travers le jeu vidéo. Il serait temps que les critiques cessent de se pâmer sur les hamburgers à 20 € et aillent manger autre chose que des hamburgers ; en d’autres termes, qu’ils fassent leur travail.
Il serait temps que j’arrête de me plaindre et que je fasse le mien.
Chapitre 5 : en réalité il s’agit de moi lol
(…) et franchement, je ne comprends pas la moitié de ce que je suis en train d’écrire.
Rassurez-vous, je ne vais pas réellement parler de moi, mais plutôt des raisons qui m’ont poussé à (mal) parler de The Last of Us Part II, de ses développeurs et de ses fans, et de le faire sur un site créé pour l’occasion, au lieu, par exemple, de le proposer à Factornews qui fut ma maison avec fierté pendant cinq ans.
En gros, c’est à cause d’un autre constat d’échec.
Tevis Thompson était un de mes critiques préférés, à la parole rare hors de Twitter, mais qui s’était tout de même fait remarquer notamment avec son brûlot “À propos des critiques de jeu vidéo”, paru la même année que The Last of Us premier du nom. J’avais perdu contact avec lui, comme avec tant d’autres, en quittant Twitter qui est un site nul de toute façon. Un jour de 2019, je suis retourné sur le site de Thompson pour savoir ce qu’il était devenu, et j’y ai découvert un feuilleton au titre pessimiste, “Ça ne reviendra pas”, encore incomplet. L’article est resté inachevé pendant des mois. Thompson avait à son tour quitté Twitter. Je l’ai oublié quelques mois, puis j’y ai repensé après avoir fini The Last of Us Part II, pour tomber sur le chapitre final de “Ça ne reviendra pas”, un monstre écrit sur 99 jours et essentiellement consacré à Fortnite. Le propos, fort intéressant au demeurant, étant que Fortnite a radicalement changé depuis l’époque où Thompson y jouait, et que le jeu qu’il a connu a disparu et “ne reviendra pas”, donc. Ainsi que sa motivation à écrire sur le jeu vidéo.
Et c’est vrai, me suis-je dit en lisant ça, que moi aussi je suis totalement passé à côté de Fortnite. Moi aussi, j’ai échoué en tant que critique. Je n’ai pas touché à Fortnite car je n’ai lu personne en parler en bien, je n’ai pas touché à des dizaines de jeux indés parce que j’ai attendu d’en entendre parler en cherchant des critiques de TLoU2 pour reconnaître leur existence. Je comptais sur des gens comme Tevis Thompson pour faire ce taf, et à présent Thompson n’écrira plus. Combien, comme lui, comme Stephen Beirne, comme Leigh Alexander, ont lâché l’affaire ? Combien de blogs ont disparu derrière des erreurs 404, comme celui qui avait traduit en français le billet de Clint Hocking sur la dissonance ludonarrative ? Thompson explique qu’il a bien songé, « l’autre soir en sortant les poubelles », à écrire à nouveau sur des jeux qui l’ont récemment marqué, avant de se rappeler « comment ça se passe », du « public », des « larbins qui continuent à défendre la forteresse de la critique JV ». J’ose espérer qu’il ne pense pas aux réacs venus, comme d’habitude, dire du mal de TLoU2 parce que ses héros ne sont pas des hommes blancs hétéros ; ceux-là sont indignes de notre temps. Mais Thompson souligne également que « nul critique n’est une île », et que la critique est avant tout une conversation. Une conversation que manifestement, il ne désire plus avoir. Une conversation que les revues modernes semblent mépriser, en reléguant leurs commentaires à des forums fangeux mal modérés, aux réseaux sociaux toxiques, voire en les supprimant de leurs sites.
C’est cette conversation que j’aimerais avoir ici. Celle que jusqu’à présent je faisais dans ma tête, en allant chercher des Youtubeurs (cette critique doit beaucoup aux vidéos de NakeyJakey, Matthewmatosis et Writing on Games, sans oublier bien sûr mon idole Tim Rogers), des blogueurs qui n’ont pas raccroché (le critique qui a écrit le bouquin de 150 pages sur Spec Ops a aussi écrit sur TLoU2) et d’autres comme Doc Burford qui constituent cette « nouvelle génération de critiques » que Tevis Thompson appelait de ses vœux. Je voudrais faire de ce site la concrétisation de ce travail, un espace où échanger ces idées dans des formes qui n’auraient pas leur place sur Twitter ou sur un site de JV traditionnel. Et puis, il me faut l’admettre, un prétexte pour me bouger les fesses et, j’espère, réussir là où j’avais échoué. Voulez-vous, vous aussi, qu’on parle de jeu vidéo, que l’on confronte nos points de vue, que l’on partage nos découvertes, pour s’ouvrir à des jeux que nous n’aurions peut-être pas trouvés autrement ? Argine est là pour ça.
